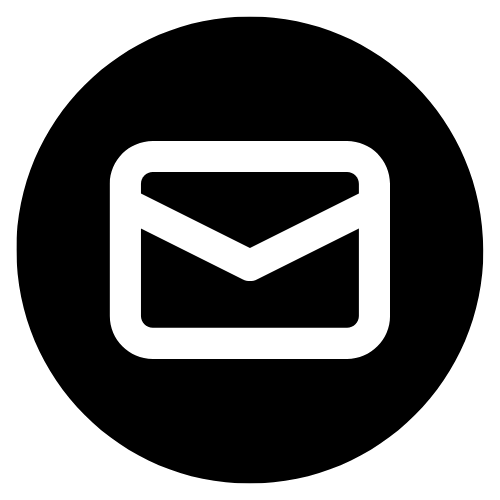L’injonction à s’épiler ou se raser fait débat chez les femmes, notamment depuis les confinements. Longtemps taboue, la parole autour du poil se libère. Mais pourquoi le poil féminin dérange-t-il autant ? Entre désir et dégoût selon les cultures, les pratiques et usages nous parlent de rapports de pouvoir dans une société qui demeure profondément patriarcale. Scarlette vous invite à un voyage à la racine de cette révolution du poil !
À chaque époque sa femme idéale
Depuis des siècles, les femmes se battent contre les diktats qui décident de leur corps — du poids à la coupe de cheveux, jusqu’au moindre poil qui dépasse. Au fil des siècles, on nous a dit comment nous devions nous habiller, nous coiffer, combien nous devions peser, mais aussi les endroits de notre corps que nous devions raser ou épiler. Chaque époque a façonné sa femme idéale, mais globalement, dans notre société en tout cas, c’est souvent une robe, des cheveux longs, pas trop grosse et la peau lisse. Voilà, c’est comme ça, débrouillez-vous avec ça.

Le poil féminin dérange : une affaire de regard
Si les pratiques ont effectivement varié en fonction des époques et des cultures, en France, la tendance est plutôt à la disparition, voire à la désintégration, du poil féminin depuis un sacré bout de temps. Coupez donc ces poils que je ne saurais voir ! Le poil chez la femme, c’est sale, c’est moche, c’est dégueulasse. Alors que, vous l’aurez peut-être remarqué, la société a tendance à sublimer le poil masculin comme un signe de virilité, de pouvoir, de sagesse (étonnant, non ?).
Blonds, bruns, roux, nos poils sont même absents de l’histoire de l’art. Essayez donc de trouver un tableau (ou une statue) où on voit des femmes avec les jambes ou les aisselles fournies !
Certaines périodes font toutefois exception, le XIXème siècle notamment, où la pilosité devient même objet d’érotisme. On peut citer le tableau de Gustave Courbet, L’Origine du monde, qui date de 1866. Mais assez étrangement, ce qui a choqué à l’époque n’est pas tant le fait de montrer un sexe féminin que la révélation de la pilosité féminine, bien cachée jusque-là.
Autre époque où certaines femmes rangent les rasoirs, les années 1970, par conviction féministe, écologiste ou/et anti-capitaliste. La pilosité est alors un symbole d’autonomie et de naturalité.

Ces poils qui nous obsèdent depuis toujours
Mais cette remise en cause ne dure pas. En 1980, c’est l’essor des bikinis et maillots échancrés, et la chasse aux poils recommence. Suit la mode du maillot brésilien dans les années 1990 avec épilation intégrale à la cire ou au sucre, une mode encore renforcée par l’influence grandissante de la pornographie.
Et on peut dire que la presse féminine s’est bien coulée dans le moule, entretenant volontiers l’idée que le poil chez la femme, c’est un peu cra-cra.
Tout ça commence très tôt. Dès le collège, et même avant parfois, l’épilation féminine débute en forme d’acte de passage pour devenir femme, « faire comme les grandes », sachant que la pilosité est aussi un signe de maturité sexuelle, et un marqueur de genre. On la qualifie même de « caractère sexuel secondaire ». Chez la femme, les poils permettent de repérer le sexe qui, par nature, n’est pas proéminent.
La rébellion contre le lisse
Mais depuis quelques années, le rapport des femmes à leurs poils se modifie. Ça commence doucement à la fin des années 90, avec des actrices comme Julia Roberts et Milla Jovovitch, qui exhibent fièrement leurs aisselles foisonnantes.
Dis ans plus tard, en 2018, un collectif féministe voit le jour, nommé « Liberté, Pilosité, Sororité ». L’objectif est de lutter contre la pilophobie (la phobie du poil) et de militer en faveur de l’acceptation de la pilosité féminine.
Le vrai virage reste toutefois la pandémie de Covid 19, au cours de laquelle certaines femmes, notamment les jeunes, découvrent avec un certain plaisir le poil en liberté. Après le premier confinement, un tiers des moins de 25 ans déclaraient se raser ou s’épiler moins souvent qu’avant.
À peu près à la même époque, en 2019, une étudiante anglaise, Laura Jackson, lance un défi, le « Januhairy », qui invite les femmes à laisser pousser leurs poils corporels pendant tout le mois de janvier. Son idée : nous inviter à réapprendre (ou apprendre tout court) à aimer et à assumer nos poils.
La violence de certaines réactions, notamment dans les sphères conservatrices, montre à quel point le sujet est moins « léger » qu’il n’y paraît, et le débat dépasse largement TikTok.
Le poil est bel et bien l’un des facteurs utilisés pour catégoriser, dominer et contrôler le corps des femmes. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, dans les milieux queer et lesbiens, on a laissé vivre le poil depuis longtemps.

L’arrêt du rasoir : un symbole d’empowerment féminin
Dans le même esprit libérateur, émancipateur que les mouvements « Body positive » ou « MeToo », les comptes et les hashtags en lien avec l’injonction liée aux poils montent en puissance sur les réseaux, amplifiant le phénomène qu’on pourrait presque qualifier de « révolution du poil ».
En janvier 2025, la tendance « Full bush in a bikini » (la touffe qui dépasse du maillot) a encore accéléré le processus. À l’origine de cet embrasement, une créatrice de contenu qui explique dans une vidéo que ce n’est pas courant de voir des femmes en maillot à la plage avec des poils pubiens apparents, et que ça n’est pas normal. Résultat, plus de 14 millions de vues…
Attention, il ne s’agit pas d’imposer le poil, mais simplement d’affirmer haut et fort que nous avons le choix ! Comme pour les cheveux gris ou blancs, comme évoqué dans le récent article de Scarlette sur la ménopause.
L’important est de s’écouter et de ne pas s’épiler ou se raser pour « faire plaisir », « faire comme tout le monde » si on a envie de garder ses poils. Et si, finalement, s’aimer au naturel était la vraie révolution ?
Car au fond, c’est peut-être ça la question à se poser : pourquoi je m’épile ? Par plaisir ? Pour me sentir belle ? Si c’est le cas, tant mieux, mais dans de nombreux cas de figure, ce n’est pas la raison première.
Autre question : pourquoi je ne me sens pas à l’aise quand je vais à la piscine ou à la plage sans m’être épilée ? On voit bien là l’importance du regard de l’autre.

Des injonctions qui nourrissent les complexes
Même pour le cheveux, il y a cette croyance tenace selon laquelle, pour être féminine, une « vraie femme », il faudrait avoir les cheveux longs. Prenez un panel d’hommes et demandez-leur s’ils préfèrent une femme aux cheveux longs ou courts…
L’air de rien, ces injonctions plus ou moins directes ont tellement ancré cette fausse idée dans les cerveaux féminins que celles qui voient leurs cheveux tomber suite à une chimiothérapie, ou en raison d’une alopécie, le vivent terriblement mal. Comme si c’était leur féminité qu’on leur ôtait.
N’oublions jamais que toutes ces injonctions nourrissent les complexes.
Au fond, ce qui se joue dans cette « révolution du poil », dans cette « rébellion contre le lisse », c’est bien la question du choix individuel, de notre choix en tant que femme. En 2025, après tous les combats féministes, le simple fait de déposer le rasoir ou la cire pose encore question. Cette fameuse question : que vont penser les autres, que va penser la société ? Alors Scarlette choisit de poser une autre question : et si on décidait de se détacher de ce regard de l’autre et de faire les choses pour soi ? Alors oui, c’est difficile, mais si on essayait ?
Poils, classe et couleur de peau : la question sociale
N’oublions pas non plus qu’il y a dans tout ça une composante sociale importante, et même une composante ethnique. Selon Léa Taieb et Juliette Lenrouilly, auteures de Parlons poil !, « une femmes blanche bourgeoise qui porte des poils, c’est une féministe bobo ultra cool, mais une femme noire précaire, elle est vue comme négligée. »
D’après les deux jeunes femmes, « c’est toujours le même profil de femmes qui cessent de s’épiler : elles ont un métier libéral, un bon niveau d’étude, d’éducation, elles vivent dans une grande ville ».
Aujourd’hui, il est difficile de savoir si cette tendance va durer. On peut au moins espérer que la possibilité de choisir sa pilosité demeure.
L’industrie de l’épilation, elle, continue à bien se porter, malgré le phénomène actuel (notamment toutes les méthodes qui font appel au laser). Elle en joue, même, en l’intégrant de plus en plus dans ces publicités. Ah, les joies du marketing !
Pour aller plus loin
Les podcasts
https://www.arteradio.com/son/le-sens-du-poil
Pourquoi tant de haine pour le poil féminin ? Qu’est-ce que cela raconte en termes d’égalité entre les femmes et les hommes, de construction de genre et de rapport à la sexualité ? Ce podcast passionnant tente d’apporter des réponses avec de nombreuses intervenantes.
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/pas-son-genre/le-sens-du-poil-9224810
Giulia Foïs, dans sa série de podcast « Pas son genre », fait aussi une incursion au pays des poils dans cet épisode, à écouter également.
Les réseaux
Sur Instagram : @parlonspoil, de Léa Taieb et Juliette Lenrouilly ; @payetonpoil créé par de jeunes féministes qui témoignent de la stigmatisation liée au poil ; @liberpilosite, le compte du collectif « Liberté, Pilosité, Sororité » ou encore @laurane.rose, compte où la créatrice de contenus Laurane Rose parle ouvertement de pilosité féminine, de son propre monosourcil, de son rapport à l’épilation et répond aux questions de ses followers, rassure et dispense des conseils et des recommandations.
Les livres
Parlons poil ! de Léa Taieb et Juliette Lenrouilly (encore elles !), aux éditions Massot.
Racines de Lou Lubie. Cette bande-dessinée, qui a eu le prix Quai des Bulles en 2024, nous raconte l’histoire de Rose, qui a les cheveux crépus et rêve de les avoir lisses. Entre enquête de société et récit de vie, l’autrice nous parle de sexisme, de racisme, d’héritage et d’acceptation de soi.
Nos poils : Mon année d’exploration du poil féminin par Lili Sohn. Lili Sohn s’épile depuis ses 12 ans. Systématiquement. Mollets, cuisses, maillot, aisselles, doigts de pied, sourcils, moustache. Un jour, elle se demande ce qui se passerait si elle décidait de se libérer de cette contrainte. Cette bande-dessinée retrace cette expérience d’un an, émaillée de références historiques et de témoignages.
Les Poils de la colère aux éditions Lapin. L’autrice de BD Vicdoux interroge les injonctions à l’épilation et invite à « rééduquer » son regard.
À chanter
Punchline de Louisadonna, avec sa première phrase merveilleuse : « La vie est trop courte pour s’épiler la chatte, j’ai pas que ça à foutre, est-ce que toi tu épluches tes tomates ? ».
Ton regard – La chanson des poils de Charlotte Saouz, chanson dans laquelle cette jeune rennaise retrace la vie d’une femme, sous le prisme des injonctions liées à l’épilation.
À poil de GiédRé, qui comme toujours nous fait rire et réfléchir.